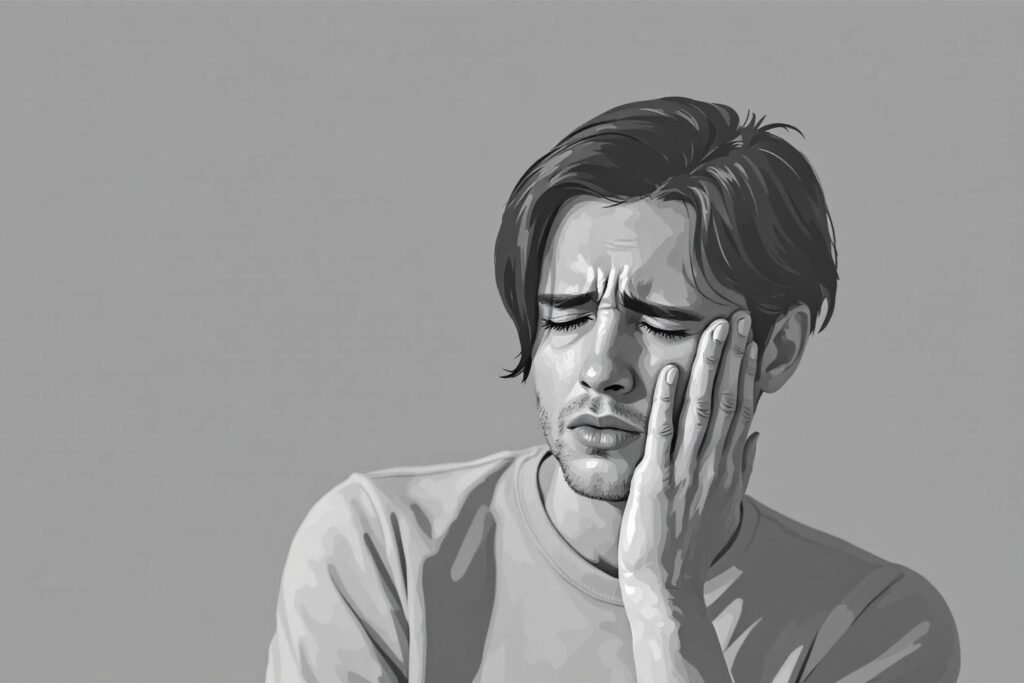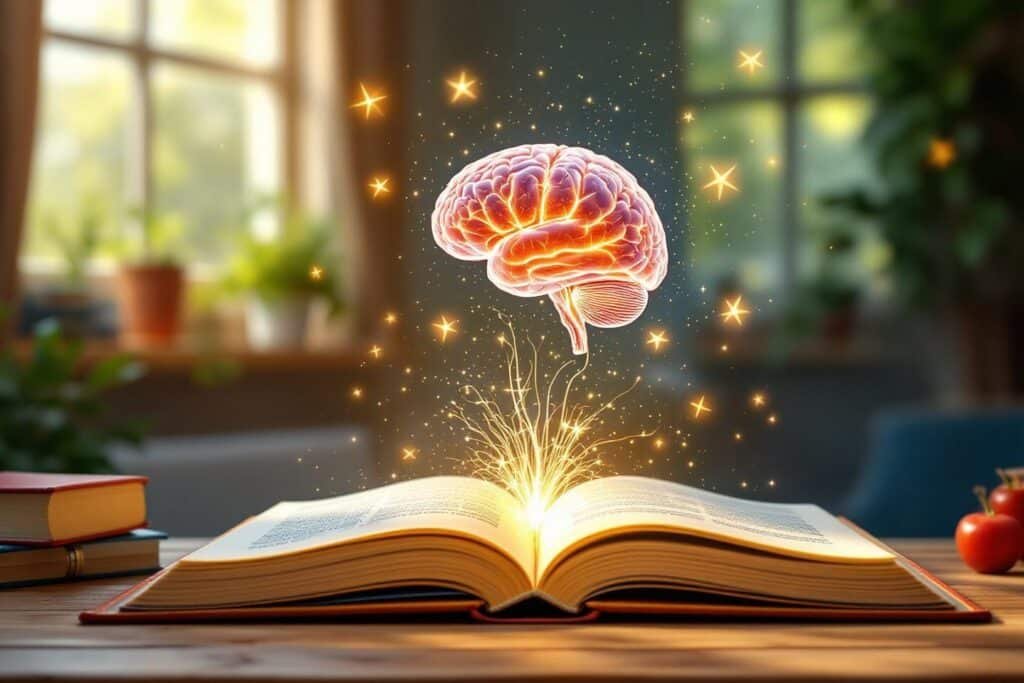L’article en bref
La recherche en biologie s’appuie sur des financements variés, jouant un rôle crucial dans les avancées médicales contemporaines.
- L’Agence Nationale de la Recherche et l’Institut National du Cancer constituent les piliers nationaux du financement, malgré une baisse de 22% en 11 ans.
- Les financements européens comme les bourses ERC représentent une manne importante, mais la France peine à les capter pleinement.
- Le secteur privé et associatif s’implique davantage via des partenariats et du capital-risque offrant de nouvelles perspectives.
- La formation doctorale bénéficie de contrats revalorisés, atteignant 2300€ brut mensuel en 2026.
Vous vous demandez comment sont financés les projets de recherche en biologie ? C’est une question cruciale tant la recherche en sciences du vivant est essentielle à nos avancées médicales et à notre compréhension du monde. Plongeons ensemble dans les mécanismes qui permettent aux chercheurs de financer leurs travaux et de faire progresser la connaissance scientifique.
Les principales sources de financement pour la recherche en biologie
La recherche en biologie bénéficie d’un écosystème complexe de financements que nous pouvons vous présenter. En France, l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) constitue le pilier central du financement, allouant environ un tiers de son budget aux projets biologiques. Ce soutien est vital pour maintenir la dynamique scientifique française.
En parallèle, l’Institut National du Cancer (INCa) joue un rôle déterminant depuis 2005 avec son programme PLBIO. En 2021, ce programme a sélectionné 55 projets sur 258 candidatures, soit un taux de succès de 21,3%, pour un financement total impressionnant de 30,8 millions d’euros. Nous constatons que ce programme maintient une certaine constance avec 52 projets financés en 2023 et 51 en 2024.
Les organismes publics nationaux
Au niveau national, les chercheurs peuvent compter sur plusieurs institutions. Hormis l’ANR et l’INCa déjà mentionnés, les collectivités territoriales apportent une contribution significative. En 2019, leur soutien a atteint 908,9 millions d’euros, répartis inégalement selon les régions.
Nous observons toutefois une tendance préoccupante : le budget destiné à la recherche en biologie-santé a diminué de 22% en 11 ans. La Loi de programmation de la recherche (LPR) vise heureusement à inverser cette tendance avec une augmentation progressive des crédits.
Les financements européens
L’Europe représente une manne financière considérable pour nos chercheurs en biologie. Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) propose des bourses prestigieuses comme les « Synergy Grant » pouvant atteindre 10 millions d’euros. Ces financements sont attribués sur le seul critère de l’excellence scientifique, sans thématique imposée.
Le programme Horizon 2020, rebaptisé Horizon Europe, offre également des opportunités majeures. Pourtant, nous devons reconnaître que la France peine encore à capter pleinement ces financements européens comparativement à certains de nos voisins.
Le secteur privé et associatif
Ne négligeons pas l’apport du secteur privé et associatif. Des fondations comme la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) ou la Fondation ARSEP pour la sclérose en plaques jouent un rôle déterminant dans le financement de projets spécifiques.
Les entreprises privées s’impliquent de plus en plus via des partenariats public-privé, notamment grâce au développement du capital-risque qui offre de nouvelles perspectives pour la recherche en biologie.
Le financement doctoral dans la recherche biologique
La formation des jeunes chercheurs constitue un pilier essentiel de la recherche en biologie. Nous disposons de plusieurs dispositifs pour soutenir les doctorants qui représentent l’avenir de notre discipline.
| Type de contrat | Caractéristiques | Rémunération |
|---|---|---|
| Contrat doctoral public | Durée 3 ans, prolongeable 2 fois d’un an | Évolutive (2200€ brut en 2025) |
| Contrat doctoral privé | Créé par la LPR en 2020 | Variable selon l’employeur |
| CIFRE | Thèse en entreprise | Minimum 1957€/mois |
| Doctorat industriel européen | 50% du temps en entreprise | Variable selon les accords |
La rémunération des contrats doctoraux connaît une revalorisation significative suite à la LPR. Ainsi, le salaire brut mensuel passera progressivement de 1866€ en 2021 à 2300€ en 2026, rendant les carrières scientifiques plus attractives.
Les Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE) méritent une attention particulière. Ce dispositif permet au doctorant de réaliser sa thèse en entreprise avec un salaire minimum de 23 484€ brut annuel, tandis que l’entreprise bénéficie d’une subvention de 14 000€.
Stratégies pour obtenir un financement de recherche en biologie
Obtenir un financement pour ses recherches n’est pas chose aisée. Nous vous recommandons plusieurs approches complémentaires pour maximiser vos chances :
- La diversification des sources de financement est essentielle pour ne pas dépendre d’un seul organisme. Analysez simultanément les pistes nationales, européennes et privées.
- La préparation minutieuse des dossiers fait souvent la différence. Adaptez votre projet aux critères spécifiques de chaque organisme financeur.
- Le développement d’un réseau professionnel solide vous ouvrira des portes. Participez activement aux conférences et colloques de votre domaine.
- La mise en avant de l’impact sociétal de vos recherches devient un critère de plus en plus déterminant dans l’obtention de financements.
Pour rester informés des opportunités, utilisez des ressources comme le portail appelsprojetsrecherche.fr qui regroupe les appels à projets de différents organismes (ANR, INCa, ADEME, Inserm). La plateforme Apogée est également précieuse pour le dépôt de certaines candidatures comme les bourses de thèses ANRS-MIE.
L’approche interdisciplinaire gagne du terrain dans les critères de sélection. Nous vous conseillons donc d’intégrer cette dimension dans vos projets pour séduire les financeurs, toujours à la recherche d’innovations à l’interface entre disciplines.
Avenir du financement de la recherche biologique
L’horizon du financement de la recherche en biologie se transforme rapidement. Nous observons plusieurs tendances qui façonneront le paysage dans les années à venir. La montée en puissance du financement privé et du capital-risque offre de nouvelles perspectives, particulièrement pour les recherches à potentiel d’application médicale ou industrielle.
Les programmes comme le PEPR eNSEMBLE, doté d’un budget de 6 millions d’euros pour des projets de collaboration numérique, illustrent l’émergence de financements ciblés sur des approches innovantes. De même, le programme Ecophyto Maturation soutient la valorisation de travaux déjà accomplis, avec un volet dédié aux innovations techniques et un autre aux innovations sociales.
La pression croissante sur les ressources publiques nous pousse à repenser les modèles de financement. La tendance est à la valorisation de l’impact sociétal et territorial des projets de recherche, ainsi qu’à l’interdisciplinarité comme levier d’innovation. Les chercheurs capables d’adapter leurs projets à ces nouvelles exigences seront les mieux placés pour obtenir des financements dans ce contexte évolutif.
Sources :